La COP30 donne une impulsion aux transports durables malgré l’impasse sur les combustibles fossiles
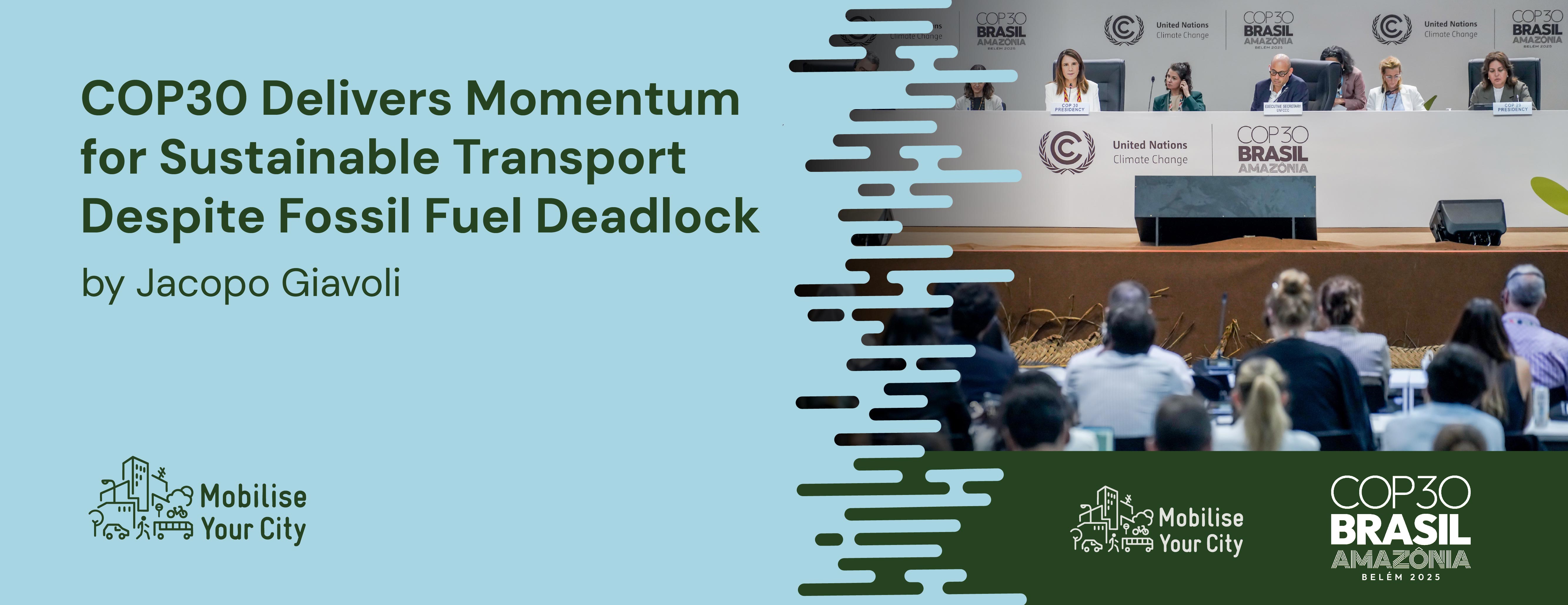
La COP30 s’est conclue samedi dernier à Belém après deux semaines intenses de négociations marquées à la fois par des avancées et par des divisions persistantes. Les pays producteurs de combustibles fossiles ont réussi à bloquer des résultats qui iraient au-delà des décisions prises à Dubaï et à Bakou. Les espoirs de voir apparaître des feuilles de route claires pour la sortie des combustibles fossiles ou l’arrêt de la déforestation ont finalement été stoppés par l’opposition des pétro-États.
Ce qui a été bloqué au niveau politique a toutefois été en partie rattrapé par l’action portée par les secteurs. Le secteur des transports, l’un des plus difficiles à décarboner, est sorti de la COP30 avec une dynamique significative. La conférence a permis des avancées concrètes grâce à des initiatives volontaires, à des mécanismes financiers renforcés et, pour la première fois, à un pavillon dédié au transport lors d’un sommet de la COP.
Élever les transports sur la scène climatique mondiale
La COP30 a marqué un tournant dans la manière dont le transport est positionné dans les négociations climatiques mondiales. Le pavillon dédié aux transports, co-organisé par le Brésil et le Partenariat SLOCAT, a offert une plateforme visible et coordonnée pour le secteur. Il est rapidement devenu un centre névralgique pour présenter des solutions concrètes, allant de l’électrification des bus aux stratégies de financement des infrastructures, ainsi qu’un lieu de dialogue de haut niveau qui était auparavant dispersé entre différents espaces.
Cette visibilité s’est traduite par une reconnaissance politique. Après un plaidoyer constant de l’UITP, les transports publics ont été inclus dans l’Agenda d’action de la Présidence de la COP sous l’Objectif clé 13. Le moment est crucial : le transport représente près de 24 % des émissions mondiales de CO₂ et doit atteindre une réduction de 59 % d’ici 2050, alors que le rail et les transports publics ne reçoivent actuellement que 23 % du financement climatique. Si le pavillon devient un élément permanent des futures COP, le secteur disposera enfin à la fois de la plateforme et de la reconnaissance nécessaires pour combler ce déficit de financement et assurer une mise en œuvre significative.
L’Effort mondial pour les transports : une référence volontaire pour l’action
Alors que les négociations formelles manquaient de résultats contraignants, la communauté du transport a fourni sa propre orientation. Le Chili a présenté un point de référence intermédiaire volontaire pour 2035 appelant à une réduction de 25 % de la demande d’énergie dans les transports et à une part d’un tiers de renouvelables, en ligne avec la feuille de route Zéro Émissions Nettes de l’Agence internationale de l’énergie. Présentée sous le nom de « Global Transport Effort », cette déclaration offre un point de référence commun pour les pays ambitieux.
Il ne s’agit pas d’un plan négocié ou prescriptif ; c’est un signal d’intention. Soutenue par dix pays, le Chili, le Brésil, le Honduras, la Colombie, la République dominicaine, l’Espagne, le Portugal, la Norvège, la Slovénie et le Costa Rica, et menée par le ministre chilien des Transports Juan Carlos Muñoz avec un fort soutien du Brésil, l’initiative crée un espace pour que les pionniers puissent avancer et encourage les autres à s’aligner.
Progrès dans l’intégration des CDN
Des avancées étaient également visibles dans les engagements nationaux. L’analyse des dernières CDN réalisée par l’UITP montre que les trois quarts incluent désormais des mesures relatives aux transports publics, contre deux tiers auparavant. La moitié des nouvelles CDN contiennent des objectifs sectoriels spécifiques, une augmentation significative par rapport aux 20 % de la précédente série. Cela reflète une reconnaissance croissante du fait que les transports publics sont essentiels pour atteindre les objectifs climatiques.
Cependant, le financement demeure un maillon faible. Près de deux tiers des CDN ne précisent pas de budgets pour les mesures en faveur des transports publics, ce qui rend difficile la mise en relation des plans avec les mécanismes de financement internationaux, y compris ceux relevant de l’article 6 de l’Accord de Paris.
Financement : libérer et amplifier le soutien à la transition
À la COP30, les pays ont convenu de tripler les financements pour l’adaptation au changement climatique d’ici 2035, indiquant que la résilience ne peut plus être repoussée. Pour le secteur des transports, cela signifie soutenir une transition juste vers une mobilité plus propre, à mesure que les véhicules électriques et les infrastructures de recharge deviennent incontournables. Veiller à ce que les travailleurs, les communautés et les petits opérateurs ne soient pas laissés pour compte est désormais une attente centrale.
L’une des discussions clés tout au long de la COP a porté sur la manière de mobiliser davantage de financements pour les transports à faibles émissions de carbone, en particulier pour les systèmes de transport public confrontés à un sous-investissement chronique. Les marchés du carbone ont été présentés comme l’un des outils les plus pratiques. S’ils sont bien conçus, accessibles aux villes, crédibles sur le plan environnemental et fondés sur des règles simples et transparentes, les crédits carbone peuvent contribuer à rendre financièrement viables des projets tels que les bus électriques, les extensions de métro ou les réseaux cyclables.
L’Accord de Paris permet de suivre deux voies complémentaires. L’article 6.2 permet aux pays et aux villes de coopérer directement pour générer et vendre des réductions d’émissions. L’article 6.4 établit un marché du carbone supervisé par l’ONU, où les acteurs publics et privés peuvent obtenir des crédits certifiés. Ces deux mécanismes peuvent réduire les risques d’investissement et attirer de nouveaux financements. La COP30 a également ouvert un nouveau débat sur la manière dont les politiques commerciales mondiales peuvent soutenir ou entraver l’action climatique. Cela élargit la conversation financière au-delà des institutions climatiques traditionnelles.
Perspectives d’avenir : une décennie de mise en œuvre
La période allant de 2026 à 2035 sera la Décennie des transports durables des Nations Unies, offrant une occasion rare de transformer les engagements mondiaux en progrès concrets. Elle coïncide avec ce que beaucoup appellent la décennie électrique décisive, au cours de laquelle les pays fixeront le rythme de l’adoption des véhicules électriques, construiront des réseaux de recharge et verrouilleront des trajectoires technologiques de long terme.
Pour les transports, cette décennie est l’occasion de passer de projets pilotes dispersés à une mise en œuvre à grande échelle et coordonnée, soutenue par des feuilles de route plus claires telles que le processus TAFF et le Global Transport Effort. Le succès dépendra de l’alignement entre la planification nationale, les mécanismes de financement et le soutien international.
La COP30 n’a pas permis d’aboutir au plan de sortie des combustibles fossiles tant attendu. Mais elle a fourni des outils, un élan politique et de nouvelles plateformes pour le secteur des transports. La tâche qui s’impose désormais est la mise en œuvre, et non de nouvelles promesses. Avec des voies de financement plus solides et une volonté politique croissante, le secteur dispose d’une base pour accélérer des changements réels et mesurables. Si les pays saisissent ce moment, la prochaine décennie pourrait devenir le tournant vers un système de mobilité véritablement bas carbone.